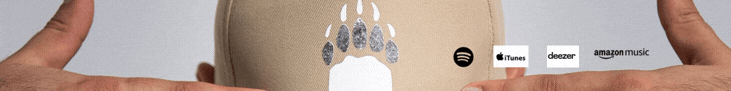{ La Carte du Rap } : Les artistes afro-descendants sur les traces de leurs origines

Ces cinq dernières années, au carrefour des cultures et des continents, de plus en plus d’artistes afro-descendants décident de retrouver leurs racines africaines. Le phénomène se dveloppe dans les esprits autant que dans les cœurs, un mouvement à la fois culturel, politique et intime.
À l’aube de la seconde moitié des années 2020, on peut remarquer des figures emblématiques traverser les frontières, retrouver leurs racines, se voir délivrer la national de leur terre-mère et renouer avec la terre de leurs ancêtres. De Ciara à Ludacris, en passant par des initiatives institutionnelles comme celles du Bénin, cette reconnexion est une véritable renaissance. La rédac a décrypté le phénomène.
Contexte : Comprendre le débat de l’identité plurielle et transcontinentale
La question de l’identité plurielle s’inscrit dans un contexte mondial. Les diasporas africaines, dispersées à travers l’Amérique, l’Europe et les Caraïbes, portent en elles une mémoire éclatée qui s’articule autour de plusieurs espaces. Les individus issus de cette histoire migratoire se trouvent souvent confrontés à une double appartenance : celle du pays où ils sont nés ou ont grandi, et celle, parfois plus diffuse, mais non moins réelle, de leurs origines africaines. Cette identité transcontinentale se nourrit d’histoires familiales, de récits de déportation et de réinvention culturelle. Elle remet en question la vision rigide de la nationalité comme unique repère de reconnaissance.
Dans ce débat, le Bénin, comme d’autres pays du continent, se lancent dans le projet de représenter des « terres symboliques » où se rejoue l’histoire. Ancien centre névralgique de la traite atlantique, le Bénin représente à la fois une blessure et une promesse. Alors, recevoir des artistes comme Ciara ou Ludacris dans un cadre de citoyenneté honorifique, c’est reconnaître l’existence de ces identités fragmentées qui cherchent à se rassembler. Mais c’est aussi poser une question plus large : qu’est-ce qu’être béninois, africain, ou afro-descendant aujourd’hui, sur un globe où les identités se construisent au croisement de plusieurs continents ?
Une identité recomposée : entre mémoire, héritage et quête de sens

L’identité des afro-descendants n’est pas figée ; elle se recompose à mesure que les générations avancent. La mémoire collective, souvent transmise à travers des récits familiaux ou des pratiques culturelles, s’avère le point de départ d’une quête personnelle. Une telle mémoire, parfois douloureuse, est marquée par la violence de l’histoire esclavagiste et par l’arrachement. Mais elle est aussi porteuse d’un héritage : celui de la résilience, des rythmes, des spiritualités et des imaginaires qui ont traversé l’océan. La quête de sens se manifeste par un besoin de réconciliation avec cette histoire. Pour beaucoup, renouer avec l’Afrique relève en effet d’une démarche existentielle. Elle permet de donner une continuité à des fragments identitaires éparpillés.
Le mouvement ne se limite pas à la reconnaissance d’un passé, il fait également écho à une volonté de s’ancrer dans un présent et un futur africain. Les artistes qui s’inscrivent dans une telle dynamique souhaitent participer activement à un narratif au travers duquel l’Afrique se révèle être un espace de création, de collaboration et de projection.
Comment le phénomène de retour a commencé
Le phénomène de retour vers l’Afrique, qualifié de « reconnexion » a aujourd’hui une ampleur nouvelle, nourrie par des dynamiques sociales, culturelles et politiques. Pendant longtemps, ce retour s’exprimait de manière individuelle, à travers des voyages initiatiques ou des recherches généalogiques personnelles. Désormais, il s’affirme comme un mouvement collectif et même « générationnel ».
L’essor des mobilités, les réseaux sociaux et la mondialisation culturelle ont accéléré le processus. Les afro-descendants disposent d’outils qui leur permettent de documenter leur histoire, d’entrer en relation directe avec les communautés africaines et de partager leurs expériences à grande échelle. Ce qui autrefois relevait d’un parcours intime est à présent un phénomène visible, relayé par des médias internationaux et soutenu par des politiques africaines de « retour aux racines ». Le Ghana, par exemple, avec son initiative « Year of Return » en 2019, a ouvert la voie en invitant la diaspora à renouer avec ses origines. Le Bénin, à son tour, multiplie les initiatives pour faire de ce retour une réalité vécue, non seulement symbolique, mais aussi institutionnelle. A cet effet, en septembre 2024, le Bénin promulgue la loi n°2024-31, une première dans son histoire qui consacre le « droit au retour », ouvrant la nationalité aux afro-descendants, preuves d’ADN ou archives à l’appui. Quelques mois plus tard, en juillet 2025, la plateforme My Afro Origins est lancée : un processus digital, multilingue, accessible en quatre langues, pour déposer sa demande depuis n’importe où dans le monde.
Ce tournant symbolise une réelle volonté de réparation historique : le Bénin assume sa part de responsabilité dans la traite atlantique, et dans le même temps, réactive une mémoire longtemps enfouie. Moins d’un an après le vote du texte, une cérémonie a lieu à Cotonou en juillet 2025 et marque une étape concrète : Ciara devient la première personnalité publique à recevoir la citoyenneté béninoise.

L’exemple de Ciara
Lorsque Ciara reçoit la nationalité béninoise en juillet 2025, loin du cliché de fait d’actualité, c’est un geste symbolique fort. La star du rnb, accompagnée du président Patrice Talon et du Ministre de la Justice, incarne ce retour aux origines dans toute sa puissance émotive. Sa visite aux sites mémoriels historiques renforce cette communion. Dans ses mots postés sur Instagram, elle évoque un retour au cœur de ce qui « compte vraiment », une expérience qu’elle dit ne pouvoir jamais oublier. Ciara devient un visage de cette nouvelle cartographie identitaire, ouverte, sensible et versée dans l’histoire.
L’exemple de Ludacris
Quelques centaines de kilomètres plus loin, au Gabon, le choix de Ludacris (Christopher Brian Bridges) de revendiquer des racines africaines apparaît tout aussi symbolique. Dès 2020, il obtient la citoyenneté gabonaise, un acte familial intime, rendu public avec délicatesse, qui tisse un lien affectif avec l’Afrique centrale. C’est surtout une reconnexion personnelle, qui démontre que ces retours sont également une transmission intergénérationnelle. Loin des projecteurs, le retour de Ludacris à ses racines est marquée par l’amour et la filiation, plus que par l’écho médiatique. En 2025, avec toute sa famille, le rappeur est revenu sur les terres gabonaises pour se se reconnecter.
Samuel L. Jackson, Issa Rae, Idris Elba…
Au-delà des exemples de Ciara et Ludacris, plusieurs figures emblématiques de l’univers de la musique et du divertissement incarnent ce mouvement de retour vers l’Afrique et de revendication d’une appartenance plurielle.
L’un des exemples les plus marquants est celui de Samuel L. Jackson. L’acteur américain, après avoir retracé ses origines grâce à des tests ADN, a reçu en 2019, la nationalité gabonaise. Une geste symbolique qui a été pour lui une façon de concrétiser une filiation retrouvée, mais aussi de se positionner comme passerelle entre Hollywood et le continent africain. Sa démarche a ouvert la voie à d’autres célébrités qui ont compris que l’Afrique pouvait être un lieu de renaissance identitaire et non plus seulement un décor exotique.
L’actrice de renom Issa Rae, très attachée à ses origines sénégalaises est un autre cas emblématique. Bien qu’elle n’ait pas encore acquis de citoyenneté africaine, elle revendique régulièrement dans ses interviews l’importance de ses racines et du Sénégal dans son parcours artistique et personnel. Son œuvre audiovisuelle, centrée sur l’expérience afro-américaine, s’inspire largement de cette double appartenance.
Dans le cinéma, on a énormément d’exemple comme Idris Elba, acteur britannique aux origines sierra-léonaises et ghanéennes qui a annonce qu’il s’installera sur le continent africain dans les cinq ou dix prochaines années. Son projet est de contribuer au développement de l’industrie cinématographique locale en créant des studios de tournage.
Stevie Wonder était déjà animée depuis 2021 par le désir de « retour au pays ». Il annonçait, vouloir s’installer au Ghana dans une interview accordée à l’animatrice et productrice Oprah Winfrey. Il souhaitait une vie meilleure pour sa descendance, loin du racisme et des tensions politiques qui secouent les États-Unis. Rita Marley, la veuve de Bob Marley, est de son côté, partie vivre au Ghana il y a bien longtemps déjà. Akon est bien plus qu’un exemple, lui qui vit pratiquement entre les USA et le Sénégal. Depuis plusieurs années, il a multiplié ses projets économiques et culturels en Afrique, notamment au Sénégal. Son projet « Akon City », bien que controversée, illustre cette volonté de réinvestir symboliquement et matériellement le continent.
Ces exemples montrent que nous assistons à un mouvement structurant, où artistes, acteurs et créateurs voient dans l’Afrique un lieu d’ancrage, de mémoire et de futur.
Impact sur la culture urbaine et musicale
L’un des symboles les plus visibles de cette reconnexion à l’Afrique se trouve dans la musique et les cultures urbaines. C’est sans doute par ce canal que le retour identitaire a trouvé son terrain le plus fertile. Depuis une dizaine d’années, la scène mondiale est traversée par une vague où les sonorités africaines occupent une place de plus en plus centrale. L’afrobeat, l’afropop, l’amapiano ou encore le coupé-décalé ne sont plus cantonnés aux pistes de danse africaines : ils irriguent désormais la pop internationale, les charts américains et européens, les festivals les plus prestigieux.
Ce phénomène favorise une recomposition prononcée de la culture urbaine. Pendant longtemps, le hip-hop, né dans le Bronx, avait concentré les codes de l’identité noire mondiale : langage, attitude, codes vestimentaires. Aujourd’hui, l’Afrique est redevenue une source d’inspiration majeure.
Les clips tournés à Lagos, Accra, Johannesburg ou Cotonou véhiculent une esthétique qui fascine autant qu’elle influence. Les rythmes africains, longtemps marginalisés, s’avèrent alors des étalons de créativité. Ils imposent de nouveaux standards dans l’industrie musicale.

Par-dessus tout, la dynamique outrepasse la musique pour toucher d’autres aspects de la culture urbaine : la danse, la mode, l’art visuel. Des chorégraphies virales issues d’Afrique de l’Ouest enflamment TikTok et Instagram. Des créateurs de mode afro-urbains imposent aujourd’hui des styles hybrides qui revisitent les codes occidentaux en les fusionnant avec les tissus et motifs africains.
La musique et l’univers urbain se veulent des terrains d’expression privilégiés pour ce retour aux origines. Ils permettent de rendre tangible une identité multiple. Le retour de figures comme Ciara ou Ludacris fait honneur à un mouvement global, celui d’une Afrique qui redéfinit les contours de la culture mondiale contemporaine.